
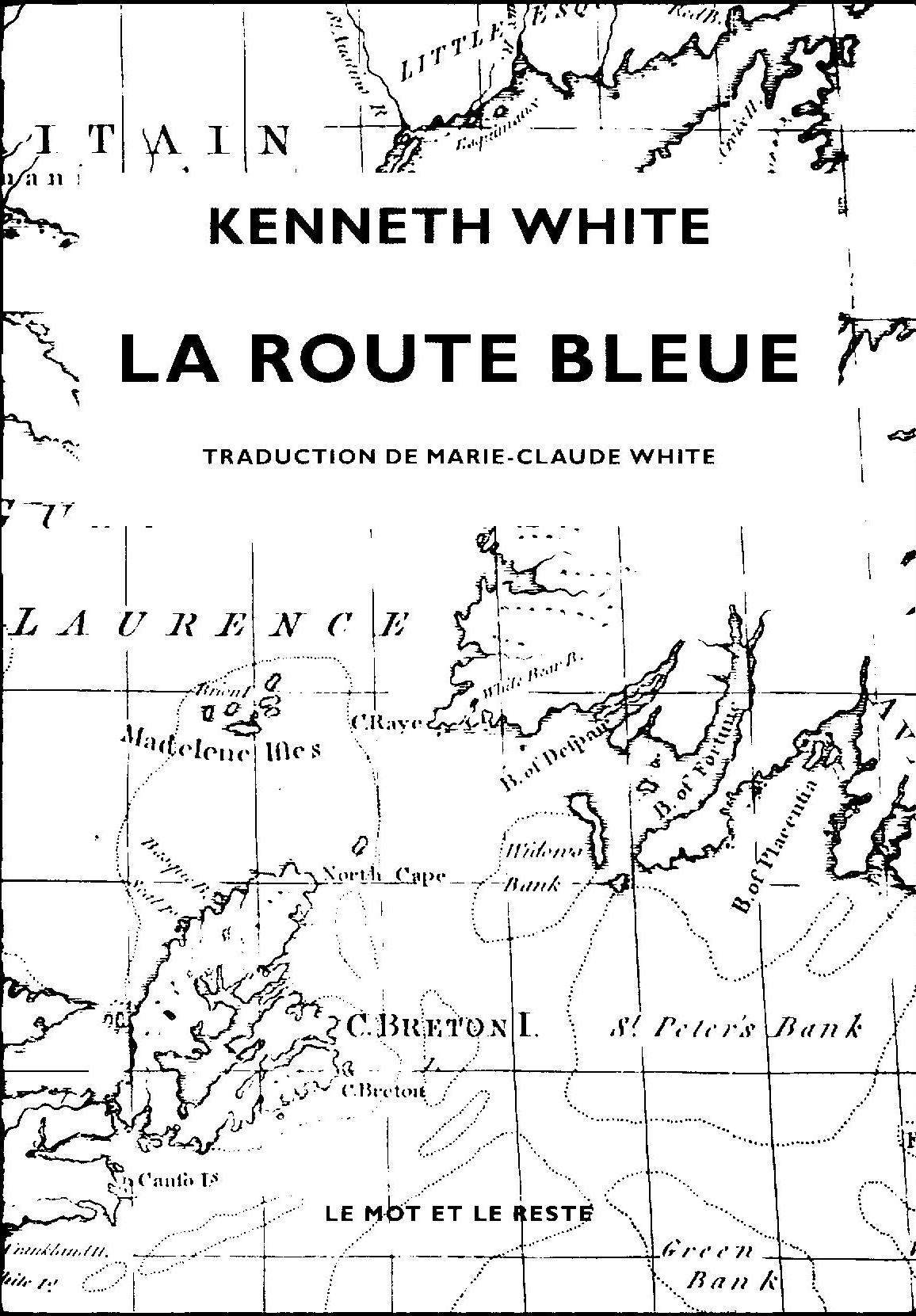
Nous avons tous voyagé, le cœur adolescent, entre les lignes de ce road-book *(*néologisme dans la lignée road-movie) de Kenneth White, en ce Labrador où le vrai or est finalement…hors lingot ! La réédition de La route bleue désormais trentenaire, dans une édition à l’élégance anglo-saxonne, titille l’œil et convoque l’esprit. L’auteur, porté par des pensées bleues comme « le ciel, le fleuve et la glace », se livre à des « méditations géomentales ». Alchimiste implicite qui mue la terre en poème, il réconcilie subrepticement le sol et l’âme. Sa « mystique » de nomade s’ancre farouchement dans le réel, un monde « à écouter ».
Maniant l’art du préliminaire, l’auteur propose deux préfaces successives : l’une rédigée dans les Côtes-du-Nord et l‘autre sur la côte nord de la Bretagne (nuance !), l’une au printemps et l’autre en hiver, l’une de l’édition originale et l’autre de la présente. De quoi se perdre dans le temps, en restant sur place dans le même tepee trébeurdenien. La route bleue, chemin du possible est désormais parcourue par un voyageur « sans espoir » (donc sans désespoir) mais à l’ « allégresse lucide ».
White avance dans l’abandon de soi sur cette route du grand Nord seule décidée à l’avance, érigeant encore et toujours le même hasard comme principe. Il chemine d’abord dans les mots et les sens, à travers des citations anciennes qui sont autant de « stèles » pas si funéraires que cela. Un extrait conduit vers l’autre de Montaigne à Rimbaud, d’Artaud jusqu’à ce « toujours plus loin » suggéré par Bataille. Cheminement que poursuivent les têtes de chapitre, sous la haute protection d’autres élu(e)s : d’Annie Lebrun à Mezzrow, de Rabelais à un poète sioux. Tant de phrases qui sont autant d’amulettes précédant et accompagnant sa fusion avec le monde et les évènements. Il se promène aussi à travers les étymologies (Innu, Chicoutimi) de noms et des lieux qui conduisent peu à peu au rêve ultime de poète en fin d’ouvrage : une terre nue et des lieux « sans nom ». Escale de route aussi ces lectures confrontées par hasard : un missionnaire qui bénit ceux que les Européens sont en train de détruire (Huard) ou une homme des Lumière (La Hontan) qui voit les Indiens comme des « philosophes nus », puis Michel Serres qui relève la parenté linguistique entre la randonnée et la hasard (random en anglais), entre White et lui (espaces blancs et pensée neuve).
Son errance est parfois ponctuée d’humour. Il écoute ainsi une chanson à la radio « aussi érotique qu’un ver solitaire » (Il est vrai qu’il est en train de manger des merguez). Il apprend tout même l’inutile : le tannage des peaux de caribou qu’il n’aura probablement jamais l’occasion de pratiquer. Il rapporte des dialogues souvent piquants avec cette employée qui croit qu’aller au Labrodor est une blague (a joke), avec l’indien de Mingan qui le détourne opportunément de son but originel pour le conduire vers des amérindiens vivant comme jadis, avec des serveuses, des Canadiennes, etc. Des discussions croustillantes avec ce pépé trappeur de 70 ans qui estime qu’ »Etre dans les bois, c’est pas voyager »), avec Eskimo Jo qui ne travaille pas mais « chôme ici ». Il nous apprend que ces Indiens ne soignent pas leur maison car ils n’aiment que les tentes, n’entretiennent pas leur jardin car ils ont l’habitude des bois.
« Glouton de savoir », l’auteur élabore l’âme d’un voyage « à la Kenneth W. ». Avec tous ces incidents et rencontres de bric et de broc…il fabrique sa « géopoésie » au jour le jour et au lieu le lieu. Elle existe vraiment à l’approche du terme du voyage. Les ombres de Trébeurden (où il vit) se conjuguent alors aux pensées extrême-orientales des haïkus, en un puzzle composite, donc réjouissant. Au terme de cette Route Bleue, le lecteur comprend que « le Labrador » est aussi en lui et que l’ouvrage est une pure invitation au voyage.
Jane Hervé


 Le festival heure par heure
Le festival heure par heure




